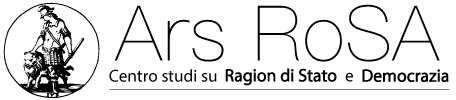di Xavier Tabet (Université Vincennes-Saint-Denis – Paris 8).
1. Cette pandémie nous a pris par surprise. Loin de moi l’idée d’exempter nos gouvernements, ne serait-ce qu’en France et en Italie, de leur imprévoyance, de leurs indécisions et voltes faces, et probablement aussi de leurs dissimulations, rendues nécessaires par le manque de moyens sanitaires pour affronter la situation d’urgence. Tout ceci est advenu après des décennies de réduction des dépenses de santé, d’austérité budgétaire, de démantèlement du service public, de recherche de la rentabilité immédiate des investissements financiers, dans l’oubli de nécessaires et indispensables «dépenses improductives». Mais le fait est que l’habitude du court terme, la difficulté de penser et agir en dehors du présent et dans la durée, ne sont pas l’apanage des seuls gouvernements, mais sont propres à notre culture moderne « liquide », celle de la discontinuité et du «perpetuum mobile», de l’éphémère et de l’oubli, de l’accélération et de la fragmentation. Par une forme de déni collectif, et en dépit de ce qui se passait en Chine, nous ne pensions pas que le monde, dans sa grande majorité, pouvait passer en si peu de temps du grand mouvement à la grande interruption. Le 19 février j’étais à Sienne pour une soutenance de thèse et à aucun moment, lors des discussions et du déjeuner avec les collègues italiens, il ne fut question du coronavirus, alors que la pandémie sévissait en Chine depuis deux mois et que l’on se doutait qu’elle s’étendait à l’Europe. Cette affaire-là devait nous apparaitre comme asiatique, liée à de sombres affaires de chauves-souris et de pangolins dans des marchés grouillants, et nous devions inconsciemment penser qu’elle ne pouvait concerner la saine et préservée Europe.
Quelques jours après, une partie de l’Italie était confinée et déclarée zone rouge. Mais là encore, de retour à Paris, je n’ai pas véritablement réalisé que cette situation de confinement plutôt strict allait bientôt être celle de la France. Et peut-être que le gouvernement français non plus ne le savait pas encore lui-même… Peu après, néanmoins, le président français, employant un vocabulaire belliqueux (plutôt inapproprié, et en tous cas assez éloigné de la novlangue de la start up nation) déclarait que nous étions en guerre. Une drôle de guerre, qui ne consiste pas à affronter l’ennemi mais plutôt à l’éviter. Une guerre qui n’est pas menée contre des ennemis extérieurs, mais dans laquelle c’est l’ensemble de l’humanité qui est censée être unie contre le virus. Or, lorsque l’on entre en guerre, on ne sait jamais quand celle-ci va s’achever. De fait, très vite l’avenir est devenu imprévisible, et les prévisions le concernant se sont avérées plus aléatoires que jamais. Nous vivons depuis lors, à n’en point douter, une période dont moins que jamais nous ne pouvons prévoir ce qu’elle apportera, lorsque l’avenir devient absolument « inscrutable ». C’est aussi ce qui est le plus impressionnant pour les populations habituées à une culture de «l’agenda» (même si la programmation est souvent limitée au court terme).

2. Selon beaucoup de gens, il existe pourtant un « message » (voire une « leçon ») du coronavirus. Mais celui-ci se présente sous la forme d’une énigme. Celle de la capacité du plus petit être vivant qui soit, le virus, à mettre à l’arrêt une grande partie du monde. Les pays les plus développés et les plus riches (mais pas seulement eux) ont semblé prêts à sacrifier durablement leur économie et leurs emplois pour préserver la vie de personnes âgées ou vulnérables, qui sont les premières à être menacées, comme on le sait, par cette pandémie. Ils ont semblé prêts à sacrifier la santé du marché pour la santé des personnes. À cet égard, on a cru distinguer, à tort ou à raison, la voie italienne d’un côté (plus « catholique », mettant à l’arrêt plus entièrement les activités économiques pour préserver le maximum de vies) et la voie anglaise et américaine (plus marquée par le protestantisme et la primauté de l’individu, et héritière aussi d’une tradition darwinienne), la France se situant dans une forme d’entre-deux. Mais il y a aussi, semble-t-il, une troisième voie : la voie germanico-scandinave qui a essayé, avec plus ou moins de réussite, de limiter au maximum les restrictions des libertés, tout en réduisant la mortalité grâce à une plus forte capacité d’anticipation et à une plus grande efficacité du système sanitaire.
Face à cette situation inédite, digne en partie d’un scénario de science-fiction, la tentation est grande de lire cette crise avec nos propres lunettes idéologiques: les collapsologues pensent que c’est le grand effondrement, les anticapitalistes la fin de l’austérité, les souverainistes celle de l’Union Européenne. Pourtant, ce message n’est pas aussi facilement déchiffrable que ne le pensent ceux qui pratiquent la mystique de la terre, la rhétorique du Petit Prince. Ou ceux qui estiment, de façon docte, que plus rien ne sera pareil qu’avant, et annoncent les grandes aubes des temps nouveaux, après la fin ou la transformation vertueuse du capitalisme, voire un «nouveau communisme» (Slavoy Žižek). De cela on peut certainement douter. En même temps, le fait est que sont devenues nécessaires, durant ce moment keynésien, certaines recettes, propres à la gauche, laquelle retrouve les vertus du Welfare State. Et que semblent disparaître – de façon temporaire, mais tout aussi rapide qu’ils semblaient indéboulonnables – certains dogmes économiques propres au capitalisme libéral.
On ne peut qu’espérer (même si cela risque d’être un vœu pieux, et que les peuples ont une mémoire courte) que cette crise, comme le sont parfois les maladies, soit une occasion de transformation, de révision, de déprise, à l’égard de certaines choses qui, auparavant déjà, dans le «monde d’avant», nous apparaissaient comme ne pouvant pas continuer, comme étant pernicieuses et néfastes. Les pandémies, on le sait, ont souvent représenté des moments de bascule entre une époque et l’autre, départagé un avant d’un après. Cette interruption volontaire nous fait voir que les règles peuvent être changées par une décision politique, même si celle-ci a été tardive et difficile à prendre. La crise est étymologiquement ce qui tranche, elle est tout à la fois une opportunité et un danger. Elle est une épreuve, et une occasion, au sens machiavélien. Elle est l’occasion de nous interroger sur ce qui nous apparait comme nécessaire et indispensable au bien-être et ce que nous estimons superflu, de réfléchir sur ce qui est important et ce qui est dérisoire. Elle nous amène à imaginer des formes d’activité et de consommation différentes de celles que nous avons pratiquées par le passé, et qui avaient souvent été présentées comme indissociables de notre modernité, avant que la pandémie ne nous montre la possibilité d’une interruption. Le mélange d’accélération des signes du changement écologique et de ralentissement de l’activité économique peut nous inciter à saisir la possibilité d’abandonner notre court-termisme collectif.
En même temps, il ne fait pas de doute que l’effort de ralentissement, voire de décroissance, sera certainement plus difficile à réaliser que ne l’a été l’arrêt momentané des activités. La tentation sera grande de considérer cette crise, pourtant probablement liée à une mutation écologique de vaste ampleur, plutôt comme un court shabbat, ou carême, de la terre, que comme un avertissement, un rappel, au sens guichardinien de ricordo, à savoir une mise en garde, un enseignement. En outre, comme le fait remarquer avec réalisme Bruno Latour, on peut craindre aussi que, passé le moment de la grande émergence, l’occasion soit belle, pour certains, de tenter de se défaire des restes de l’État-providence, et d’une partie des règlementations contre la pollution. Enfin, il faut dire aussi que toutes ces incertitudes sont renforcées par la nature tout à fait inédite de cette catastrophe hybride, à cheval entre la catastrophe humaine et la catastrophe naturelle, causée moitié par l’homme, moitié par la nature ; une crise de l’économie réelle, de l’offre et non de la demande, qui n’est pas due à un dysfonctionnement de la machine, mais à son arrêt volontaire, sans que l’on sache si la machine pourra redémarrer, se remettre en marche après qu’on l’a arrêtée.
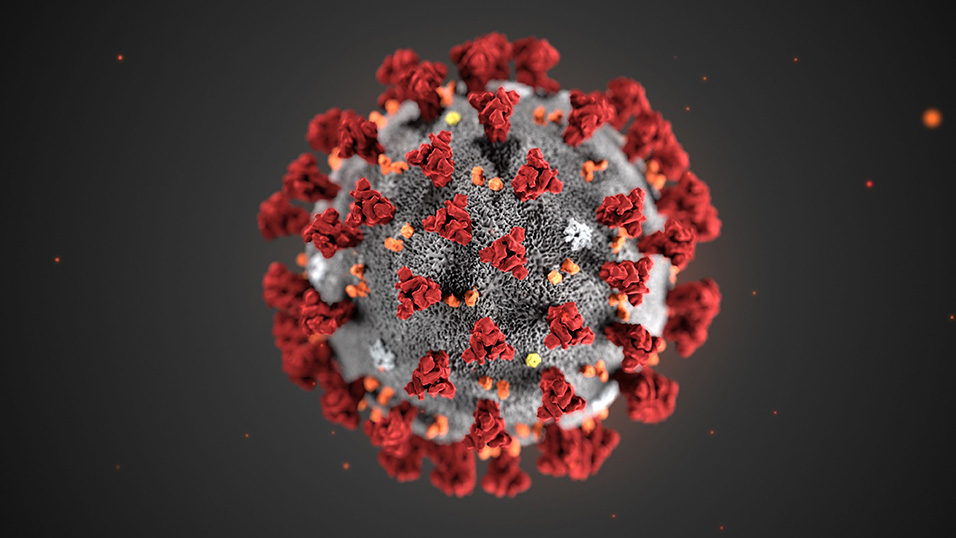
3. Cette épidémie était tout à la fois, comme le rappellent les virologues et les spécialistes des pandémies, imprévisible et inévitable à l’époque de la mondialisation extrême. Attendu inattendu, l’événement constitue souvent une forme de précipité de l’époque, il est «un fait porteur d’une idée», pour employer une formule de Jean-Paul Sartre. Certes nous ne vivons pas tous la crise actuelle dans les mêmes conditions, et les inégalités sont accentuées par les conditions mêmes du confinement. En même temps, comme tout grand événement, sa caractéristique est de nous concerner tous, sans que l’on puisse y rester extérieur, tant il est vrai qu’il n’y a pas d’intériorité indemne de l’Histoire. Nous éprouvons ici, pour la première fois peut-être, la globalité et l’interconnexion de notre monde. Même si notre conscience de la nécessité d’affronter les épidémies de façon mondiale, et pas seulement nationale, date au moins du XIXème siècle et de la lutte contre le choléra, cette pandémie nous prouve de façon manifeste que nous formons une même humanité. D’une certaine façon, la pandémie a réalisé ce que la lutte contre le réchauffement climatique n’a pas réussi à faire, l’écologie n’ayant jamais réussi à devenir la véritable « religion civile » de notre époque.
Malgré toutes ces incertitudes, et en partie à cause d’elles, la situation que nous vivons nous oblige à penser en prise directe avec le présent. Cela ne veut pas dire essayer de prédire l’avenir, activité plus que jamais difficile, mais plutôt tenter de faire un diagnostic, ou un inventaire, du présent. Le fait est que la situation que nous vivons met elle-même à l’épreuve nos savoirs et nos discours. Un grand événement c’est toujours quelque chose qui nous oblige à penser. Il nous amène à nous ouvrir à des discours et des problématiques qui n’étaient pas nécessairement les nôtres auparavant. Il n’en reste pas moins vrai que, en dépit du lien complexe entre les différents versants (sanitaire, économique, politique, juridique, et bien entendu écologique) de la crise, chacun l’appréhende à l’aune de sa propre sensibilité, et de ses propres questionnements. Ceci est d’autant plus inévitable que l’état d’urgence sanitaire met en lumière un grand nombre de phénomènes qui étaient déjà ceux que l’on pouvait observer depuis un certain temps ; il mène souvent à son paroxysme toute une série de tendances qui avaient déjà été décrites par le passé.

Observée à la lumière des enseignements foucaldiens sur la biopolitique, cette crise nous montre combien la vie, et le droit à la vie, sont devenus l’enjeu des luttes politiques. Le confinement que nous vivons s’inscrit dans l’horizon général de la défense de la vie sous la forme de la santé, et de la prise en charge, en masse, des populations par l’Etat. Il est un mécanisme de sécurité global fonctionnant à l’échelle d’une population, effectuant une opération et de séparation et de massification. Cette opération demande le consentement actif de la population, avec une suspension partielle du droit. Elle tend nécessairement vers l’état d’exception, lorsque le gouvernement légifère par ordonnances, suspend de facto le parlement, et soustrait au contrôle de l’autorité judiciaire nombre d’actes administratifs. Avec la vie devenue le terrain principal de la décision politique, on peut observer de façon manifeste, à travers la prise directe qui s’opère sur le vivant, à la fois une médicalisation de la politique et une politisation de la médecine, lorsque l’action politique tend à se penser sur un mode médical et que les enjeux de la médecine se politisent.
Depuis 1945, le droit à la vie est devenu le droit sacré par excellence. La Déclaration universelle des droits de l’homme (1948) a installé la vie au coeur de la politique, et ouvert un champ très étendu au droit qui protège la vie. On est passé définitivement, si l’on peut dire, de la question du salut de l’âme à celle de la protection de la vie. Par une forme de sécularisation du salut, le désir de sécurité et les impératifs du souci de soi ont été rabattus sur le soin et la santé. Comme l’écrivait Michel Foucault dans son cours de 1977-78 (Sécurité, territoire, population), « la fin dernière de l’homme ce n’est plus la jouissance de Dieu, c’est la bonne santé ». En 1945, après l’époque du salut de l’Etat – un Etat divinisé par les totalitarismes -, on en est venu à la question du salut de l’humanité. La leçon de la seconde guerre mondiale est qu’aucune vie n’est indigne d’être vécue, et que l’intangibilité de la dignité humaine représente l’impératif fondamental, « quoi qu’il en coûte », selon les termes employés par le président Macron. En dépit de la position initiale d’un Boris Johnson, ou de celle d’un Donald Trump affirmant qu’il fallait s’en remettre à Dieu, c’est cette nouveauté étonnante qui a été illustrée, lors de la crise que nous vivons, par la réaction des Etats qui, sans céder à la tentation utilitariste, ont dans leur immense majorité refusé la sélection naturelle qu’aurait entraîné la voie de l’immunisation collective sans confinement. Et la Chine elle-même – certes après d’évidentes tergiversations et tentatives d’occultation et de répression des lanceurs d’alerte – a dû se plier à cet impératif, payant elle aussi son tribut éthique à la mondialisation.
Mais la situation que nous vivons illustre en même temps certains des dangers propres à nos «démocraties immunitaires». Elle nous rappelle, de façon tragique, qu’exister (ce qui n’est pas la même chose que seulement vivre, ou survivre) c’est être exposé. Exister c’est, comme l’indique son étymologie latine, se «tenir hors». Lorsque la protection de la «vie nue» nous oblige à renoncer, au nom de la sécurité du vivant, à toutes les «formes de vie» qui sont les nôtres, et à l’instauration du règne durable de la distance et du masque, la «vie sacrée» court le danger de se transformer en négation, voire en sacrifice de la vie elle-même. Comme l’écrivait Roberto Esposito dans Termini della politica, vol.I, 2018, d’une façon qui nous apparaît aujourd’hui terriblement actuelle : «L’immunità, benché necessaria alla vita, una volta portata al dilà di una certa soglia, la costringe in una sorta di gabbia in cui finisce per perdersi non solo la nostra libertà ma il senso stesso della nostra esistenza, quell’apertura dell’esistenza fuori di se stesso cui si è dato il nome di comunità (…). L’immunità a dosi elevate è il sacrificio del vivente alle ragioni della semplice sopravvivenza. La riduzione della via a nuda vita biologica» (trad. fr. : « Amenée au-delà d’un certain seuil, l’immunité, bien que nécessaire à la vie, la contraint dans une sorte de cage où finit par se perdre non seulement notre liberté mais le sens même de notre existence, cette ouverture de l’existence en dehors d’elle-même à laquelle on a donné le nom de communauté (…). L’immunité à doses élevées est le sacrifice du vivant aux raisons de la simple survie. La réduction de la vie à la vie nue biologique»).
Au début des années 1920, dans un texte intitulé Critique de la violence, Walter Benjamin estimait qu’il vaudrait la peine de faire une recherche à propos du dogme affirmant le caractère sacré de la vie, «à titre d’ultime égarement de la tradition occidentale affaiblie qui cherche dans le cosmologiquement impénétrable le sacré qu’elle a perdu». Ce qu’il voulait dire – en évoquant les risques d’une vie ramenée entièrement à elle-même par la sécularisation des références religieuses, une vie devenue toute entière zoe et non plus bios – c’est que «l’homme précisément ne doit être confondu à aucun prix avec la simple vie qui est en lui, ni avec cette simple vie ni avec n’importe quelle autre de ses qualités, disons plus: pas même avec l’unicité de sa personne physique». Par-delà la seule survie, il s’agit bien de continuer à vivre une vie pleinement humaine, c’est-à-dire de vivre une vie qui affirme des valeurs plus hautes que la seule survie biologique. Après 1945, la grandeur de la littérature concentrationnaire sera, il me semble, d’illustrer avec un terrible réalisme la volonté de la survie dans les situations extrêmes; et en même temps aussi, chez ses plus grands auteurs (Jean Améry, en particulier, dans son dialogue avec Primo Levi), le prix humain très élevé à payer pour cette survie.
4. En France, la protection des personnes âgées dans les Ehpad a montré combien la conservation de la vie, et l’impératif de la survie, risque de se transformer en une mise à l’écart, en un inquiétant isolement, voire en une forme de «bannissement». Nous présentons la survie de nonagénaires, voire de centenaires, que l’on nous montre parfois sortant victorieusement des hôpitaux, après avoir vaincu la maladie, comme les véritables «survivants» de notre époque. Celle-ci a fait de la conservation de la vie une religion. Ces victoires illustrent notre obsession de durer pour durer, de vivre et «faire vivre» le plus longtemps possible. L’existence est rabattue sur le vivant, le droit de vivre assimilé au droit à la vie, la vie bonne réduite à la vie longue, le genre humain ramené à l’espèce humaine.

L’épidémie nous renvoie en même temps à un passé révolu, où la médecine était impuissante. Le retour de la mort semble défier le déni de la mort qui hante nos sociétés. Depuis longtemps, celles-ci cultivent l’oubli de la mort, en tentant de la mettre hors jeu, hors champ, en la cachant au sein des hôpitaux et des asiles. Notre époque prend conscience du retour de la mort, en dépit de la «pudeur» que la mort lui inspire, depuis que tout ce qui touche à la mort est devenu, comme l’écrivait l’historien Philippe Ariès dans les années 1970, «infectieux», ou obscène, lorsque l’interdit de la mort a succédé à l’interdit victorien du sexe. Ce retour représente un défi à notre croyance dans les pouvoirs de la médecine, parfois contrainte, dans les moments les plus dramatiques de cette crise, à devoir choisir entre ceux qu’elle peut «faire vivre» et ceux qu’elle s’est parfois trouvée contrainte à «laisser mourir». Certes la mort continue plus que jamais, en cette période de confinement, d’être reléguée à l’intérieur des hôpitaux, et les enterrements et cérémonies religieuses sont plus que jamais réduits, comme par une sorte de «deuil du deuil». Mais en même temps, notre société qui se pensait souvent sur le mode du virtuel doit affronter le retour de l’archaïque et du primordial. Loin des illusions pernicieuses du trans-humanisme, et de la croyance dans une technique qui remplacerait la nature, avec l’illusion d’éliminer la mort, c’est dans la reconduction brutale au réel que s’effectue le retour aux données de base, le rappel de notre appartenance à la nature.
5. La question de la sécurité constitue le cadre dans lequel se situe l’autre ensemble de questions fondamentales que pose la situation actuelle. Liées aux problématiques inaugurées par Michel Foucault dans la seconde moitié des années 1970 (à une époque où le thème de la biopolitique apparaissait comme une notion abstraite), ces questions ont trait au problème de la constitution, de plus en plus manifeste, de «sociétés de contrôle», comme les appelait pour sa part Gilles Deleuze dès 1990. Des sociétés fonctionnant davantage en vertu du «principe sécurité» qu’à travers les seuls mécanismes disciplinaires, lesquels sont souvent considérés par les populations, avec soupçon, comme des instruments du pouvoir. La sécurité, devenue plus que jamais «bio-sécurité», concerne quant à elle le substrat biologique le plus élémentaire de l’homme. S’enracinant dans le vital bien plus que dans le juridique, et finissant par englober les anciens «droits de l’homme», la sécurité entend garantir non pas tant les droits de la communauté politique des citoyens que la santé et la protection de «la grande communauté sensible des sujets vulnérables» (Frédéric Gros).
À une époque où le mythe de la transparence est puissant, le contrôle devient plus que jamais participatif. Il vise avant tout à réguler et à aménager un milieu, par évaluation continue, plutôt qu’à soumettre, ordonner et diriger. Son dispositif principal relève moins de l’enfermement et de la ségrégation que de la traçabilité des individus. La gouvernementalité contemporaine, qui a pour cible la population et non le peuple – et dont Foucault a montré qu’elle consistait d’abord à organiser et orienter les stratégies que les individus mettent en oeuvre les uns par rapport aux autres – fonctionne non pas selon le principe de l’obligation et l’asservissement, mais dans une articulation entre les politiques sécuritaires et l’extension du domaine de la responsabilité individuelle, de la contrainte volontaire, différente de la pure et simple obéissance. C’est dans ce cadre que se situe le débat très actuel autour des usages du «traçage», le contact tracing, le geotracking, à savoir la géolocalisation des individus au moyen de leur téléphone, lui-même couplé à d’autres machines, et en passe de devenir une sorte de nouveau bracelet électronique, de panopticon digital. Ce débat suffit à lui seul à illustrer le fait que l’équilibre entre la défense des libertés et les tendances sécuritaires reste plus que jamais l’un des grands défis (et soucis) de notre époque. Le risque est bien entendu que certains dispositifs sanitaires deviennent permanents, une forme de nouvelle normalité, dans une sorte de brouillage inquiétant des lignes de partage entre les dictatures policières et les démocraties libérales. On peut en effet craindre que ces mesures d’exception, par lesquelles des pouvoirs exceptionnels ont été conférés à l’administration, se perpétuent une fois la crise passée, et que certains dispositifs se conservent dans le droit commun. En France, ces inquiétudes se sont manifestées déjà à propos des dispositifs adoptés à l’occasion d’une autre soi-disant guerre, celle contre le terrorisme, lorsqu’une partie des mesures liées à l’état d’urgence est devenue droit commun depuis 2018.
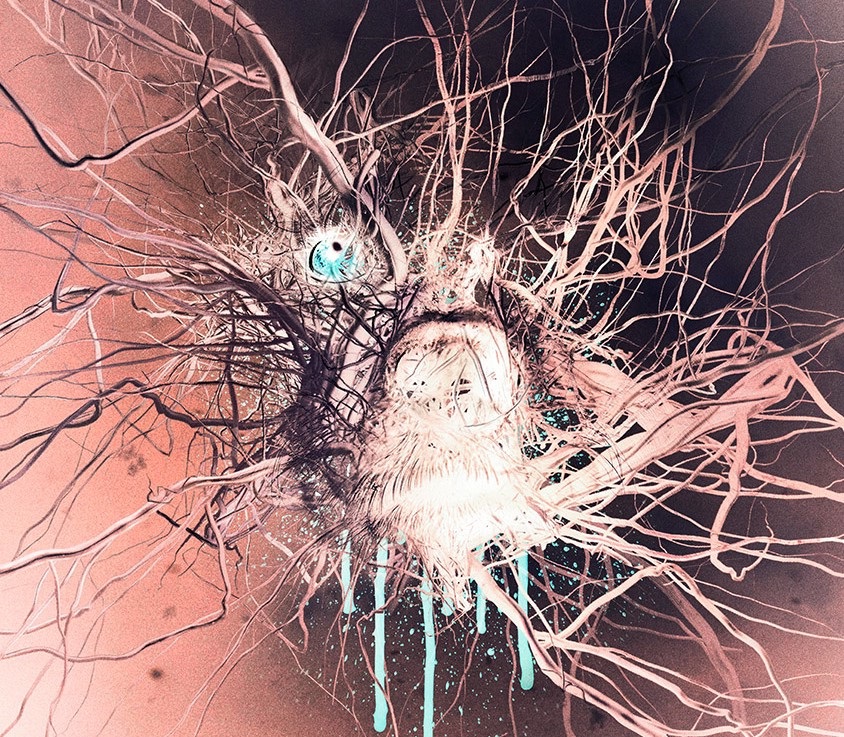
Ce risque est d’autant plus réel que l’évident désir d’exposition des individus à travers les réseaux sociaux les amène déjà à accepter, sans aucune contrainte mais de façon tout à fait volontaire, de céder une grande partie de leur «données personnelles». Comme l’annonçait avec clarté en 2010 le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg lui-même, «la protection de la vie privée n’est plus la norme sociale». Lorsque se brouille la frontière entre espaces publics et espaces privés, la nouvelle société qui se dessine là peut être tout à la fois une «société d’exposition» et une société sans contact, une société de contrôle et en même temps d’auto-contrôle, où la saisie biopolitique se double d’une sorte de demande de consentement. Lorsque les pouvoirs politiques relèvent de plus en plus de la forme générale du pastorat, l’Etat sanitaire est appelé à travailler sur le grain fin des conduites et des comportements individuels. Et le lien apparaît toujours plus évident entre l’accroissement des mécanismes de sécurisation de l’existence et la production de formes inquiétantes de dépolitisation de la vie. La prise directe qui s’opère sur le vivant, sur les gens en tant que corps individuels ou masse vivante, diffère en effet de la façon dont un citoyen, un sujet de droit, comparaît devant la loi. En dépit de son caractère inédit, voire inaugural, le moment que nous vivons accentue indéniablement certains phénomènes déjà manifestes auparavant. Bien entendu, cette épidémie n’a pas été «inventée» selon l’expression malheureuse du philosophe Giorgio Agamben. L’état de panique, voire la «panique d’Etat», n’a pas été induit par les gouvernements, afin de satisfaire un désir de sécurité amenant à une suspension des libertés. Ce moment n’en constitue peut-être pas moins un laboratoire où se préparent les nouveaux agencements politiques et sociaux, pour la mise en place de certains dispositifs qui ne sont pas prêts de disparaitre.
6. Nous sommes à présent dans le moment de l’héroïsation des soignants et de ceux que l’on présente comme étant «au front», dans une crise qui renverse en partie les hiérarchies de l’utilité sociale des professions. Cette héroïsation est en même temps le pendant d’une certaine culpabilisation des populations, et de leur répression (avec en France, à la mi-avril, aux dires du ministre français de l’Intérieur, déjà plus de 700.000 amendes infligées). Chaque individu devient un irrégulier, un «sans papier» potentiel, un «suspect objectif», assigné à montrer son permis de circuler, en vertu d’une situation qui était auparavant propre à certaines parties de la population, estimées potentiellement plus dangereuses que d’autres, et dont l’ensemble de la population fait à présent l’expérience. Pour le moment, il faut, avec Machiavel, «estimer comme un bien le moindre mal». Mais en même temps, l’esprit critique est, comme on le sait, souvent la première victime des époques de «mobilisation totale» (une mobilisation qui prend ici la forme paradoxale de la démobilisation). L’action collective implique un contact physique entre les gens. Passé déjà le moment de la rhétorique du rassemblement et de l’unité nationale, celui de la politique et des clarifications est en passe d’arriver. Du reste, déjà le calme apparent du confinement est rompu par les files d’attente aux distributions de nourriture et de produits de première nécessité à des gens appauvris par une précarité déjà existante.
Bientôt beaucoup voudront tirer parti de la situation actuelle, voire la prolonger, en renforçant, autour de la notion de risque, le caractère autoritaire de nos «Etats de vigilance», hantés par le rêve d’abolir la contingence et l’angoisse face à un réel comportant, de fait, toujours plus d’incertitudes. Beaucoup voudront, à n’en point douter, faire fructifier un « capital peur ». Celui-ci pourra être alimenté par ceux-là même qui prétendront l’éradiquer. Beaucoup tenteront certainement aussi de nous convaincre de la nécessité du repli sur des idées fermées de la nation, de la communauté, devenue communauté de la peur, ainsi que sur les différentes cultures du soupçon, de la distance, et de la dangerosité. Ils tenteront d’exploiter nos désirs de murs, en réactivant la mystique des frontières, et en transformant la politique en politique immunitaire, où chaque personne doit se protéger des autres. De toute évidence, nous ne sommes qu’au début d’une période qui risque de nous réserver des surprises, et de contenir bien des plis (et des replis). Déjà on entend aussi le discours libéral retrouver de la voix et, dans le but de nous ramener vers les impératifs du marché, rejoindre certaines critiques du droit à la vie et de ses impasses, propres à un discours venant de bords politiques et philosophiques différents. Rappelons-nous qu’une politique de la vie est traversée par des pulsions de mort, et que la défense du vivant peut se transformer en son élimination, voire en une thanatopolitique.
Sans céder à notre tour au vice de la prédiction, gageons que, dans l’articulation du biopouvoir et du libéralisme autoritaire, les nouvelles formes du capitalisme numérique vont toujours plus s’imbriquer aux aspirations sécuritaires, à la tentation d’immuniser nos vies à outrance, c’est-à-dire aussi à l’état d’alerte et au qui-vive permanent. Lorsque le système immunitaire devient fort au point de se retourner contre lui-même, la maladie auto-immunitaire peut représenter un venin pour l’organisme, à l’image de ce virus dont, si l’on en croit les spécialistes, un excès de réaction immune serait à l’origine des cas les plus sévères, comme par une forme d’emballement du système immunitaire. Plus que jamais il convient de résister aux dérives immunitaires, à la peur des indésirables, aux pulsions éradicatrices, à l’intégrisme de la sécurité. Plus que jamais il convient de préserver, et d’élargir, l’espace du bien commun, et de penser la communauté sous des formes ouvertes, comme extériorité. Plus que jamais, la catastrophe, selon le mot de Walter Benjamin, c’est quand tout continue comme avant.
 Stampa questo articolo
Stampa questo articolo